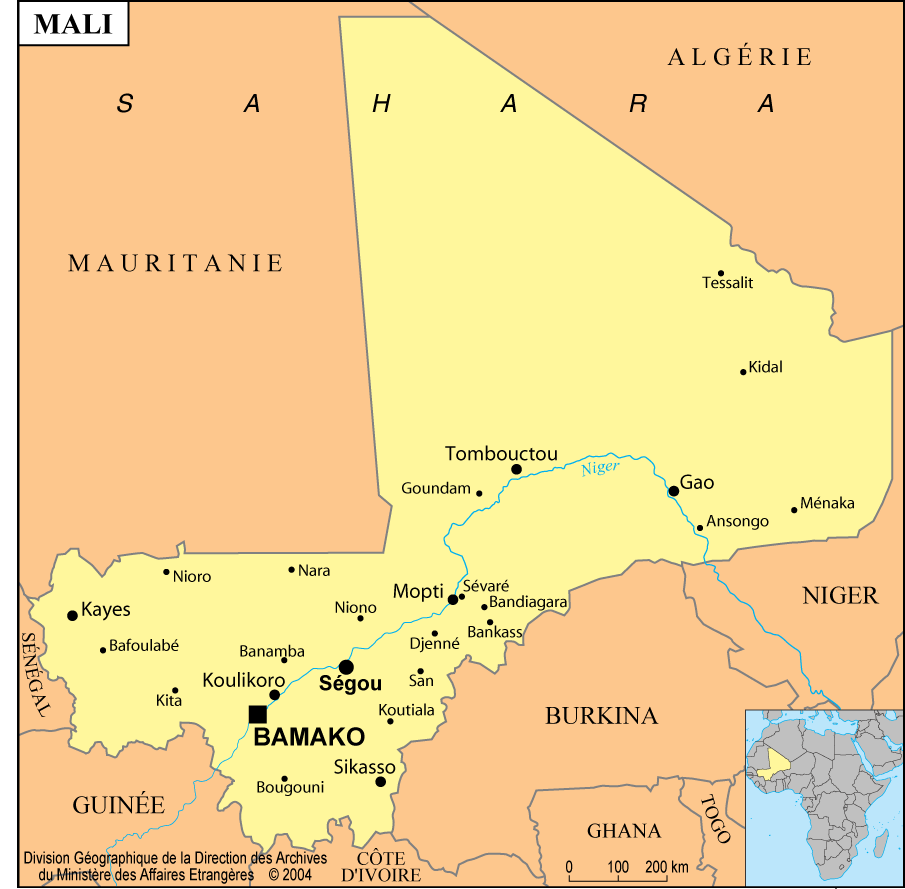De l’antique empire du Ghana au tata de Babemba, en passant par les sublimes legs du Mali, du Songhaï et du Macina, sans oublier les postures chevaleresques des Amonakels, la patrie de Kankan Moussa, de par sa contribution remarquable à la création de bastions de civilisations, représente pour notre continent, ce que fut la Grèce ancienne pour l’Europe : une matrice culturelle féconde, créatrice de sens et libératrice de l’esprit humain.
L’attachement à ce Mali éternel nous impose donc se devoir d’inventaire, sans concession, pour mieux comprendre les maux qui accablent le Mali contemporain. Ces maux sont aussi les nôtres. Prenons garde !
La démographie galopante, le chômage structurel de la jeunesse, l’explosion des réseaux sociaux qui bouleversent les paradigmes traditionnels, l’urbanisation sauvage, la mal gouvernance chronique, l’absence de créativité politique et institutionnelle capable de prendre en charge des mutations denses et globales, déclenchent partout à travers l’Afrique de puissantes dynamiques qui convergent vers des épilogues désastreux, à moins d’un sursaut gigantesque et solidaire. Oui, le Mali préfigure nos épreuves de demain. Il est ce laboratoire des alternatives quasi inéluctables. En guise de conclusion sacrée et fraternelle, nous dirons que le Mali sera ou nous ne serons pas.
Le Mali, cet immense et précieux voisin, est au carrefour de son destin. L’insécurité exponentielle qui y règne, en plus de la faillite du système de gouvernance, est source légitime d’une grave préoccupation, voire de frayeur. Avant d’en venir aux conséquences tragiques de cette crise et à ses répercussions potentiellement dévastatrices, un détour séquentiel est nécessaire afin d’en appréhender les péripéties historiques. Elle est, avant tout, le résultat d’une trajectoire chaotique provoquée par la combinaison de plusieurs facteurs dans la longue durée : mauvaises options des gouvernements successifs, ruptures institutionnelles répétitives, environnement géopolitique défavorable, mutations socioculturelles négatives, tout relié, d’une manière ou d’une autre, au marqueur d’intensité des phénomènes subversifs qu’est la question touarègue. Cette crise, comme dans la plupart des pays africains, est avant tout, une crise de construction de l’État – Nation. Le projet d’un État fort, centralisateur, faisant abstraction des différences multiformes qui caractérisent sa réalité démographique, s’est heurté dès l’aube de l’indépendance à la défiance d’une partie des populations du Nord, notamment Touaregs. Habitant de part et d’autre de la frontière algéro-malienne, le puissant sous-groupe des Ifoghas des Adrars avait caressé au moment des indépendances le rêve d’un rattachement à l’Algérie, après l’échec du projet colonial de l’Organisation commune des régions sahariennes. Le refus de la France d’accorder une suite favorable à cette revendication est considéré, par eux, comme une dette morale que l’ancien colonisateur doit porter sur sa conscience.
Cependant, faut-il voir dans le refus presque atavique de certains Touaregs d’être commandés par une majorité écrasante des Noirs du Centre et du Sud comme l’expression du mépris, voire du racisme ?
Les détracteurs de la cause touarègue en sont convaincus, tandis que les intéressés rejettent l’accusation avec véhémence. Quoiqu’il en soit, dès 1963, une première rébellion touarègue éclata sous Modibo Keita. Cette insurrection précoce appelée « Alfellaga » est promptement réprimée avec l’aide de l’Algérie et du Maroc.
Outre le soutien ferme de l’Algérie, qui était redevable au Mali pour avoir hébergé l’aile Sud du FLN (Front de Libération nationale) basée à Gao et dirigée par feu Abdelaziz Bouteflika pendant la guerre de libération, le régime de Modibo Keita put aussi compter sur une armée disciplinée, entrainée, sous le commandement du charismatique général Abdoulaye Soumaré.
La grande ferveur patriotique qui agrégeait les consciences anticoloniales entrainait aussi dans son sillage un nombre important de cadres du Nord tous défavorables à cette première rébellion d’origine féodale.
La férocité de la répression qui s’abattit sur les insurgés contribuera à sédimenter dans leurs cœurs et dans les esprits un ressentiment durable et une méfiance instinctive.
Le régime de Modibo Keita avait une base solide au départ. Il portera très haut le prestige international du Mali. Au plan interne, il a construit un État fort et amorcé une industrialisation volontariste.
Toutefois, l’autre aspect de son bilan, occulté par ses thuriféraires, est loin d’être reluisant : en effet, le premier président du Mali a enfermé dans les bagnes de Taoudenit et de Kidal ses opposants emblématiques, parmi eux Fily Dabo Cissokho et Hamadoun Dicko, sous prétexte de complots avec des « preuves » laborieusement exposées. Le socialisme économique radical qu’il instaura dans un pays héritier d’une longue tradition de liberté commerciale, sans compter les dérives des miliciens, favorisera l’émergence d’un front hostile et déterminé contre son régime. Il est aussi vrai que son engagement en faveur des mouvements de libération de l’Afrique dérangeait considérablement le camp occidental. En 1968, il est déposé par un groupe de militaires dirigé par Moussa Traoré. La nouvelle junte hérita d’un outil de défense solide et du soutien actif de l’Algérie.
Sous le règne de Moussa Traoré, deux grands cycles de sécheresse, au début des années 1973 et au début des années 1980, éprouveront durement les nomades du Nord. Ces cycles de sécheresse conduiront beaucoup de Touaregs à l’exil, dont une grande partie en Libye. Une vérité historique doit être martelée : sans Mouammar el Kadhafi, la rébellion touarègue n’aurait jamais connu une telle évolution militaire.
Les ténors de cette rébellion ont été tous formés dans les armées de l’ex-guide de la Jamahiriya. Iyad Ag Ghali, l’homme qui perturbe aujourd’hui le sommeil des dirigeants de la région, a été un combattant de premier plan dans la légion islamique de Kadhafi. À ce titre, il a fait la guerre à Beyrouth aux côtés des Palestiniens lors du siège de la capitale libanaise par l’armée israélienne.
Les grandes figures militaires touarègues que sont les Hassan Ag Fagaga, Ibrahim Ag Bahanga, Shindouk Ould Najim (chef d’état-major du MNLA) sont tous passées par les académies libyennes, en dépit de l’implication de leurs devanciers dans les premières rébellions.
À ce stade, une parenthèse utile s’impose. Les Touaregs sont très divers. Le sous-groupe des Ifoghas des Adrars, qui est au centre des rébellions récurrentes, est la classe dite « noble » et dirigeante. Les Ifoghas ont des alliés fidèles. La classe historiquement servile des Imaghas est démographiquement très importante. De toute façon, il faudra un orfèvre en ethnographie et en anthropologie pour démêler l’atomisation des groupes et des sous-groupes composant le monde touareg.
Question : une gestion démocratique du terroir avec le suffrage universel serait-elle de nature à bouleverser la hiérarchie du pouvoir dans le monde touareg ?
Certains y voient l’une des causes du refus de normalisation politique et administrative de la classe des féodaux.
D’autres Touaregs, très nombreux, et éloignés de l’épicentre des Adrars, comme ceux de Ménaka et ailleurs (tels que les Ouellmedins), ne partagent pas forcément l’objectif de la rébellion.
Une autre réalité amplifie aussi la volatilité de la situation. L’État central malien, du premier régime de Modibo Keita au dernier régime d’IBK, a malheureusement échoué dans trois domaines de gouvernance essentiels : le désenclavement conséquent, la décentralisation effective et efficiente et l’inclusive culturelle des minorités dans l’espace public.
Toujours est-il qu’en 1990 la deuxième rébellion touarègue éclate par l’attaque du camp militaire de Ménaka. Au nom de son mouvement dénommé MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Azawad), Iyad Ag Ghali revendique l’attaque. Son mouvement fédérait autour de lui beaucoup de sensibilités touarègues, en dehors des Ifoghas dont il est issu.
En janvier 1991, le régime finissant de Moussa Traoré signe avec cette rébellion les « Accords de Tamanrasset ». En mars 1991, il est renversé par l’armée. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré (ATT) prend la direction de la Transition qui dura jusqu’en juin 1992. À la veille de son départ, il signera avec les rebelles un « Pacte national » qui renforçait les accords de Tamanrasset.
Pendant la transition, une conférence nationale fut organisée pour faire table rase du passé et acter l’avènement d’un régime dit démocratique.