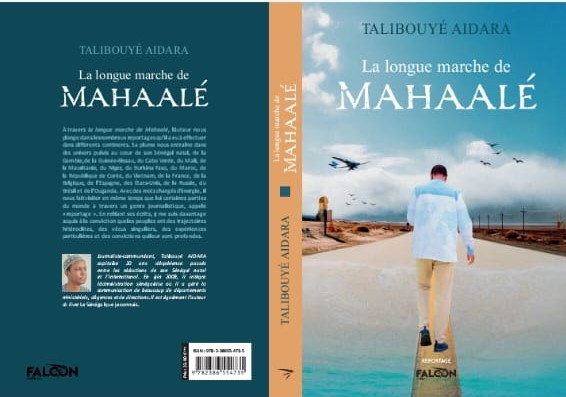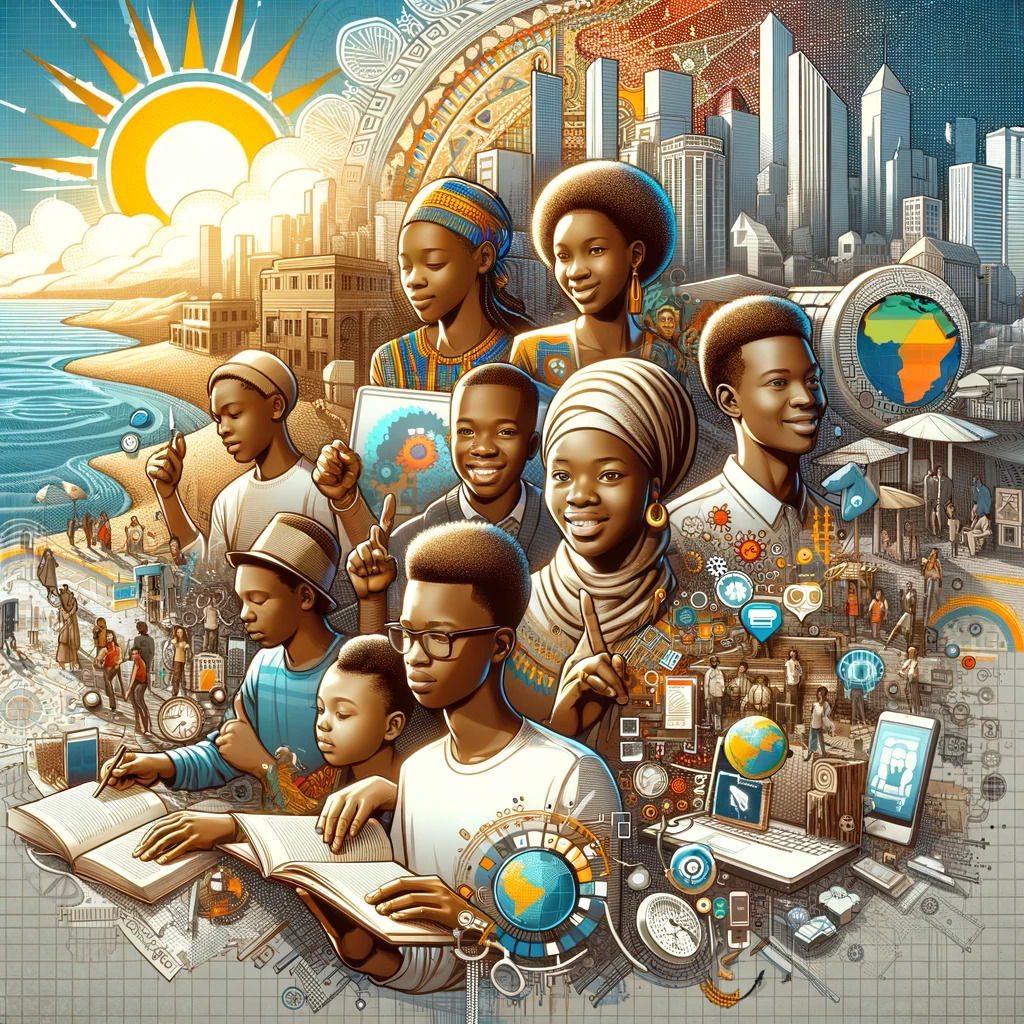L’émigration en Afrique de l’Ouest s’impose aujourd’hui comme l’un des phénomènes les plus marquants de la région. Chaque année, des milliers de personnes quittent leur pays, parfois au péril de leur vie, dans l’espoir de trouver ailleurs ce qu’elles ne parviennent plus à obtenir chez elles : un emploi stable, une sécurité pour leur famille, un avenir meilleur. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, près de 9,5 millions de personnes vivent déjà comme migrants à l’intérieur de la sous-région, soit environ 2,5 % de la population totale. Si l’opinion publique retient surtout les images des pirogues en partance pour l’Europe, la réalité est que l’essentiel des mobilités reste intra-africaine, avec des flux massifs entre pays voisins comme le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigéria, ou encore le Mali et le Sénégal.
Les causes de ces départs sont multiples mais convergent vers une même réalité : le manque de perspectives. La jeunesse, qui représente plus de 60 % de la population ouest-africaine, est la plus touchée. Au Sénégal, près de 20 % des diplômés restent sans emploi, et au Nigéria le chômage des jeunes dépasse 30 %, soit plus de 20 millions de personnes. À cette crise de l’emploi s’ajoutent les pressions environnementales. Le Sahel, fortement exposé au changement climatique, voit ses terres se dégrader, ses ressources en eau s’amenuiser et ses rendements agricoles chuter. Entre 2010 et 2020, les récoltes céréalières ont baissé de près de 15 % au Niger et au Mali, poussant de nombreux paysans et éleveurs vers l’exode. Enfin, l’instabilité politique et les conflits armés aggravent la situation : au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la montée du terrorisme a provoqué le déplacement de plus de trois millions de personnes, dont beaucoup franchissent les frontières pour chercher refuge ailleurs.
Les routes empruntées par les migrants témoignent de la complexité et de la dangerosité du phénomène. La traversée du Sahara, qui mène vers la Libye ou l’Algérie, est devenue un piège mortel où se mêlent violences, trafics et détentions arbitraires. Par la mer, les départs se multiplient également. En 2023, plus de 40 000 migrants ont tenté la traversée de l’Atlantique pour rejoindre les Canaries, selon Frontex, une route particulièrement périlleuse pour les embarcations de fortune. Mais derrière ces images spectaculaires, il faut rappeler que la majorité des migrations se fait dans la sous-région, souvent de manière saisonnière et discrète, au gré des besoins en main-d’œuvre.
L’impact économique de ces départs est considérable. Les transferts de fonds envoyés par la diaspora constituent une véritable bouée de sauvetage pour les familles restées au pays. En 2022, le Nigéria a reçu plus de 20 milliards de dollars, soit 4 % de son PIB, tandis que le Sénégal a bénéficié de 3,7 milliards de dollars, représentant près de 10 % de son PIB. Ces sommes financent la consommation des ménages, l’éducation des enfants et même certains projets immobiliers ou entrepreneuriaux. Pourtant, cette ressource précieuse a aussi ses limites : elle crée une dépendance et ne compense pas la fuite des compétences qui prive la région de ses forces vives. Dans le secteur de la santé par exemple, plus de 30 % des médecins formés au Nigéria exercent aujourd’hui à l’étranger.
Face à cette réalité, les États ouest-africains et la CEDEAO tentent de réagir. Des accords de libre circulation encadrent les déplacements intra-régionaux, des programmes de réinsertion sont mis en place pour les migrants de retour, et des plans de formation et d’emploi cherchent à retenir les jeunes sur place. Mais les résultats restent limités car les causes profondes — pauvreté, instabilité et changements climatiques — continuent d’alimenter la migration.
Ainsi, l’émigration en Afrique de l’Ouest ne peut être réduite à une simple fuite vers l’Europe. Elle est le reflet d’un déséquilibre social et économique, à la fois moteur d’opportunités pour les familles qui survivent grâce aux envois de fonds, et source d’inquiétude pour des États qui voient leurs forces vives quitter le territoire. Plus qu’un drame humain, elle est le miroir d’un continent en quête de solutions et d’avenir.