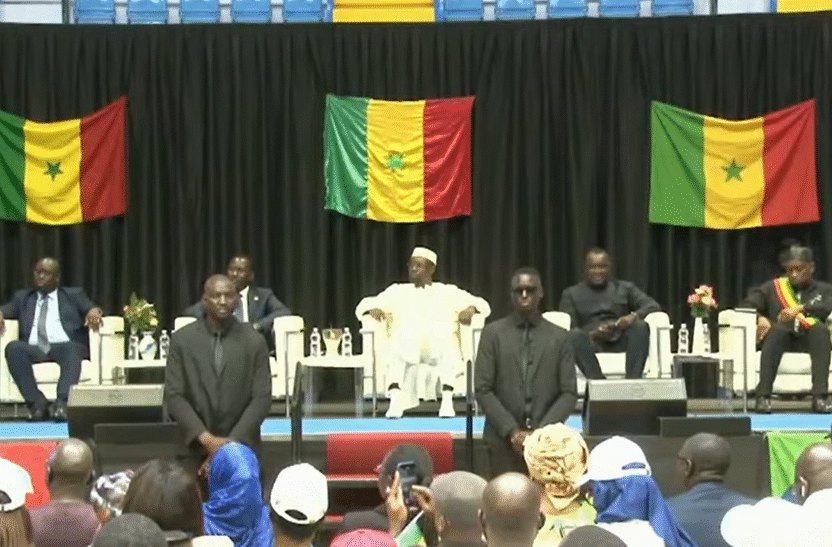La vallée du fleuve Sénégal, et particulièrement le Fouta Toro, a connu une transformation majeure au cours des dernières décennies avec la construction des deux grands barrages de l’OMVS : Diama, près de Saint-Louis, et Manantali, au Mali. Inaugurés dans les années 1980, ces ouvrages devaient faire de la vallée un espace moderne de production agricole et énergétique, et assurer une meilleure sécurité alimentaire aux populations riveraines. Si ces infrastructures ont permis des avancées notables, elles ont aussi entraîné des effets inattendus, voire négatifs, qui expliquent les désillusions actuelles des habitants du Fouta.
Le barrage de Diama, achevé en 1986, avait pour objectif principal d’empêcher la remontée de l’eau salée de l’Atlantique dans le fleuve, protégeant ainsi les terres agricoles du delta. Il devait aussi faciliter l’irrigation et améliorer l’accès à l’eau potable. Celui de Manantali, mis en service en 1987, visait à réguler le débit du fleuve, à produire de l’électricité et à offrir des possibilités d’irrigation à grande échelle. Ces projets représentaient donc des leviers de modernisation et des promesses de prospérité pour les populations locales.
Sur le plan énergétique, Manantali constitue une pièce maîtresse : il dispose d’une capacité installée de 200 MW et produit en moyenne 807 GWh par an. L’électricité est répartie entre trois pays : le Mali en reçoit environ 52 %, le Sénégal 33 % et la Mauritanie 15 %. Cette production a contribué à réduire la dépendance énergétique des États de l’OMVS, mais des difficultés persistent : par exemple, la dette du Mali envers la SOGEM dépasse aujourd’hui 94 millions de dollars, menaçant la continuité d’exploitation de l’ouvrage.
Sur le plan agricole, la maîtrise de l’eau a permis un essor sans précédent de la riziculture irriguée. Dans la vallée, les superficies aménagées sont passées de 37 000 hectares en 2013 à près de 49 000 hectares en 2018. En 2022, plus de 47 000 hectares ont été emblavés en riz avec des rendements souvent supérieurs à 6,5 tonnes/ha, atteignant parfois 8 à 9 tonnes. En 2024, la production de riz paddy dans la vallée a atteint 343 000 tonnes, avec un objectif de 420 000 tonnes en 2025. À Matam, la SAED a même doublé la surface de riziculture en contre-saison, passant de 1 672 hectares à 4 000 hectares. Ces chiffres montrent l’ampleur des transformations agricoles permises par les barrages.
Cependant, les limites sont nombreuses. Malgré ces progrès, le Sénégal reste dépendant des importations : près de 70 à 80 % du riz consommé est encore importé, preuve que l’autosuffisance reste un objectif lointain. Les rendements varient fortement d’une zone à l’autre, et les inondations endommagent régulièrement les périmètres irrigués : à Bakel, par exemple, 90 % des périmètres cultivés ont récemment été ravagés par les eaux. L’accès aux intrants agricoles, aux financements et aux équipements reste inégal, marginalisant une partie des paysans qui ne parviennent pas à intégrer l’agriculture moderne.
Au-delà de l’agriculture et de l’énergie, les impacts négatifs des barrages sont multiples. La disparition des crues naturelles a bouleversé l’écosystème : les sols se régénèrent moins, la biodiversité aquatique a chuté et la pêche artisanale, autrefois abondante, est en déclin. L’eau stagnante a favorisé la propagation de maladies comme la bilharziose et le paludisme, tandis que l’irrigation mal maîtrisée entraîne salinisation et acidification des sols. Les systèmes économiques traditionnels — agriculture de décrue, élevage et pêche — ont été fragilisés, privant de nombreuses familles de leurs revenus. Face à ces difficultés, les jeunes migrent massivement vers Dakar, les grandes villes, ou encore vers l’Europe et les États-Unis. Les barrages, censés fixer les populations, alimentent paradoxalement l’exode rural et l’émigration internationale.
Ainsi, les barrages de Diama et de Manantali illustrent le paradoxe du développement par les grands projets hydrauliques. Ils ont permis une avancée incontestable dans la maîtrise de l’eau, la production agricole et l’électricité, mais leurs bénéfices sont inégalement répartis et leurs effets écologiques et sociaux sont lourds. Pour les habitants du Fouta Toro, ces ouvrages sont synonymes à la fois de promesses et de désillusions : promesses d’un développement agricole moderne, désillusions face à la marginalisation, aux inégalités croissantes et à la perte des modes de vie traditionnels. Aujourd’hui, l’enjeu n’est plus de savoir si les barrages étaient nécessaires, mais de définir une gouvernance inclusive et durable, afin que les populations du Fouta, héritières séculaires du fleuve, soient réellement les premières bénéficiaires des richesses qu’il génère.